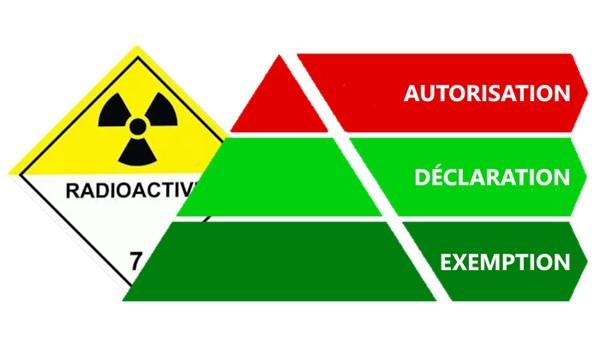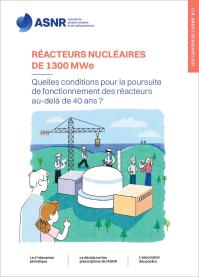Le groupe permanent d’experts pour les déchets émet ses recommandations sur la sûreté à long terme de Cigéo en phase d’après-fermeture et formule sa conclusion générale.
À l’issue de la phase d’instruction technique de la demande d’autorisation de création de Cigéo, l’ASNR a présenté son 3ème rapport d’expertise au groupe permanent d’experts pour les déchets, qui a émis ses recommandations sur la sûreté à long terme de Cigéo en phase d’après-fermeture, et a formulé sa conclusion générale sur le dossier.
- La troisième et dernière phase de l’instruction technique du dossier de demande d’autorisation de création de Cigéo s’est conclue avec la réunion du groupe permanent d’experts pour les déchets (GPD) les 25 et 26 juin 2025. Cette troisième phase portait sur la sûreté de Cigéo en phase d’après-fermeture. Les discussions du GPD se sont basées sur l’expertise réalisée par la direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR.
- Le GPD a estimé que la démonstration de la sûreté en après-fermeture présentée par l’Andra est satisfaisante pour ce stade de développement du projet, compte tenu des engagements pris par l’Andra et sous réserve de la prise en compte des observations qu’il a formulées à l’issue de son examen. Il considère que le système de stockage, dans l’architecture retenue, présente une bonne capacité globale de confinement et est robuste vis-à-vis de l’ensemble des risques et incertitudes considérés en après-fermeture.
- À l’issue de l’examen de l’ensemble du dossier de demande déposé par l’Andra, le groupe permanent considère que la démonstration de sûreté de Cigéo repose sur une base solide de connaissances et a atteint le niveau de maturité requis à ce stade. Il a néanmoins soulevé certains enjeux importants, qui appellent des compléments et devront faire l’objet d’évaluations à l’occasion de jalons à venir dans le développement du projet.
- L’ASNR rendra son avis sur la demande d’autorisation de création de Cigéo, conformément aux dispositions de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, dans l’objectif d’éclairer le public sur cette demande en vue de l’enquête publique. L’ASNR présentera, dans cet avis prévu à la mi-novembre 2025, sur la base de sa propre expertise et des recommandations du GPD, les éléments qu’elle juge nécessaires pour compléter la démonstration de sûreté en vue de la mise à jour du dossier prévu avant l’enquête publique, ainsi que ceux attendus aux étapes ultérieures du développement du projet Cigéo.
- Les parties prenantes engagées dans les différentes démarches de dialogue mis en œuvre par l’ASNR au cours de l’expertise et de l’instruction techniques seront consultées à l’automne dans le cadre de la préparation de cet avis, afin d’avoir un continuum de participation de la société civile sur les phases de saisine, d’expertise et d’instruction de l’ASNR et de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la perspective des consultations réglementaires à venir, en particulier l’enquête publique prévue en 2026.
L’Andra a déposé auprès du ministère de la transition énergétique, le 16 janvier 2023, la demande d’autorisation de création (DAC) d’une installation de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde dénommée Cigéo. L’ASNR a été saisie par le ministère de la transition énergétique, en mars 2023, pour piloter l’instruction technique de cette demande.
L’ASN a souhaité que l’expertise du dossier de demande soit organisée selon trois groupements thématiques : les données de base retenues pour l’évaluation de sûreté de Cigéo, la sûreté en phase d’exploitation des installations de surface et souterraine et la sûreté après fermeture. Des thèmes transverses sont également étudiés, tels que la réversibilité (incluant le principe d’adaptabilité du stockage et de récupérabilité des colis de déchets radioactifs en vérifiant l’absence d’incidences négatives sur la sûreté en après-fermeture), la phase industrielle pilote et les conséquences liées au changement climatique. La première phase s’est conclue par une réunion du groupe permanent d’experts pour les déchets (GPD) les 24 et 25 avril 2024, et la deuxième phase les 10 et 11 décembre 2024.
La direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR a présenté son expertise et le groupe permanent d’experts pour les déchets (GPD) a examiné, les 25 et 26 juin 2025, avec l’appui de membres des groupes permanents d’experts pour les laboratoires et les usines (GPU) et pour la radioprotection des travailleurs, du public, des patients et de l’environnement (GPRP), le troisième groupement thématique, puis a formulé sa conclusion générale à l’issue de l’examen de l’ensemble du dossier déposé par l’Andra.
Un dialogue technique a été organisé à destination de la société civile par l’ANCCLI, le CLIS de Bure et l’ASNR durant l’expertise du DDAC de Cigéo. Il a démarré début 2023 et se terminera début octobre 2025. Les objectifs sont de tenir compte des préoccupations et des questions de la société civile pour rendre plus robuste l’expertise de l’ASNR et de permettre à société civile de se forger leur propre opinion sur les sujets de sûreté nucléaire et de radioprotection et participer ainsi au processus conduisant à la décision publique.
En parallèle, l’ASNR a mené une concertation sur le projet de saisine globale de l’IRSN et les projets de saisines du groupe permanent d’experts « déchets » pour recueillir l’avis de parties prenantes participant au groupe de travail du PNGMDR.
Concernant l’examen du troisième groupement thématique portant sur la sûreté en après-fermeture de Cigéo, les éléments de conclusion suivants ont été mis en lumière par l’expertise réalisée par la direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR.
La démonstration de sûreté de Cigéo après sa fermeture a atteint le niveau de maturité requis au stade d’une demande d’autorisation de création d’un stockage. La pertinence de la démarche retenue par l’Andra pour évaluer la sûreté de Cigéo après sa fermeture a été soulignée, celle-ci étant fondée sur l’examen de sa performance de confinement via des scénarios d’évolution du stockage déduits d’une analyse globalement satisfaisante des risques sur le long terme et des incertitudes associées à la performance de ses composants.
L’évaluation du scénario d’évolution normale du stockage (SEN), qui correspond à l’évolution prévisible de l’installation et du milieu géologique, montre une bonne capacité de confinement du système de stockage. La poursuite des efforts de consolidation des connaissances, en particulier relatives à la solubilité du sélénium ou encore aux propriétés hydrauliques de la formation géologique du Callovo-Oxforien (COx), reste toutefois nécessaire afin de dégager des marges par rapport aux objectifs de protection radiologique.
Les scénarios de dysfonctionnement des scellements ou des conteneurs de stockage HA, ainsi que d’effondrement d’un alvéole durant la phase d’exploitation, qui conduisent à des performances de confinement dégradées, présentent des impacts sanitaires du même niveau qu’en SEN. Ces impacts peuvent néanmoins être plus élevés pour les scénarios postulant une faille non détectée dans le quartier de stockage MA-VL ou une intrusion humaine involontaire, sans pour autant être inacceptables au regard de la très faible vraisemblance des scénarios retenus et de la sévérité des hypothèses qui les fondent. Il a été noté que l’Andra s’était engagée, en réponse à une demande sociétale, à prendre en considération un scénario d’abandon du stockage avant sa fermeture dans l’objectif d’identifier, le cas échéant, des modalités de fermeture anticipée du stockage qui en limiteraient les conséquences sur la sûreté à long terme ; cela a été considéré satisfaisant compte tenu de la durée séculaire de son exploitation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le système de stockage, dans l’architecture retenue, est apparu robuste vis-à-vis des risques et incertitudes liées à son évolution. Les évaluations des impacts environnementaux, tant radiologiques que chimiques, ainsi que des impacts sanitaires chimiques, concluent à des niveaux très faibles.
En revanche, en l’absence d’une comparaison étayée entre plusieurs options d’architecture au regard de critères relatifs à la sûreté en exploitation et après fermeture (déjà soulignée par l’ASN à l’issue de l’expertise du dossier d’options de sûreté), la direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR n’a pu se prononcer sur le caractère optimisé de l’architecture du stockage retenue au stade du DDAC, sans toutefois préjuger qu’elle ne le soit pas. Du point de vue de la sûreté après fermeture, cette architecture confère une importance supplémentaire aux scellements des galeries en ne mettant pas à profit le gain avéré d’un positionnement du quartier de stockage MA-VL en aval hydraulique des liaisons surface-fond (LSF). A cet égard, la justification du nombre, de la localisation et de la performance des scellements des galeries dans l’architecture retenue reste à apporter.
Sur la préservation de la mémoire, le travail de préfiguration engagé par l’Andra est estimé satisfaisant au stade actuel du développement du projet, et doit se poursuivre.
Enfin, bien qu’aucun point rédhibitoire lié à la sûreté après fermeture du stockage de l’inventaire de réserve n’ait été identifié à ce stade des études d’adaptabilité, les efforts à mener pour démontrer l’absence de risque de criticité à long terme du stockage des combustibles usés (CU) restent substantiels, dès lors que le maintien de leur géométrie ne serait plus garanti.
Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2025, le GPD a confirmé les principaux éléments de conclusion de l’expertise réalisée par la direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR, et en particulier celle sur la bonne capacité globale de confinement et la robustesse du système de stockage dans l’architecture retenue. Le GPD a néanmoins davantage mis en exergue la nécessité d’évaluer le degré de conservatisme par rapport aux objectifs de protection radiologique de l’évaluation en situation enveloppe du scénario postulant un forage abandonné au niveau du stockage. S’agissant de la maîtrise du risque de criticité lié au stockage de l’inventaire de référence, le GPD estime également que les éléments présentés par l’Andra vont dans le sens de la démonstration d’une absence de criticité après fermeture du stockage pour l’inventaire de référence. Toutefois, le GPD souligne que l’exclusion de criticité, si elle est satisfaisante sur le principe, peut s’avérer délicate à démontrer eu égard aux échelles de temps à considérer. Enfin, s’agissant de l’optimisation de l’architecture actuellement retenue vis-à-vis de la sûreté en exploitation et après fermeture, le GPD relève que l’Andra a étudié l’incidence de la longueur des galeries sur les gains possibles en termes de performance de confinement, mais n’a pas répondu à l’ensemble de la demande de l’ASN formulée à ce sujet à l’issue de l’instruction du DOS. Le GPD estime en conséquence que l’Andra devra compléter son dossier afin de justifier le positionnement du quartier de stockage MA-VL par rapport aux LSF, ainsi que le nombre et la localisation des scellements des galeries dans l’architecture retenue.
En conclusion générale, la direction de la recherche et de l’expertise en environnement de l’ASNR ainsi que le GPD ont souligné les avancées notables de la démonstration de sûreté de Cigéo depuis le DOS (dossier d’options de sûreté), tant dans la constitution du socle de connaissances qui la fonde, que dans son évaluation en phase d’exploitation et après fermeture. Cette démonstration a globalement atteint le niveau de maturité requis à ce stade pour l’architecture retenue et doit désormais être complétée et consolidée. Il convient à cet égard de rappeler la spécificité temporelle du projet Cigéo, qui dispose notamment d’une phase industrielle pilote d’une durée estimée à une trentaine d’années à partir de la délivrance du décret d’autorisation de création. Durant cette phase, destinée à asseoir la démonstration de sûreté du stockage au moyen d’études et d’essais réalisés dans son environnement géologique et dans des conditions représentatives de son fonctionnement industriel, les compléments et consolidations identifiés comme nécessaires à l’issue de l’expertise du DDAC devront faire l’objet de rendez-vous d’évaluation programmés en amont de la mise en service de l’installation actuellement envisagée par l’Andra à l’horizon 2050, par exemple à l’occasion du franchissement de jalons techniques clés tels que le début du creusement, ou l’engagement de la construction du premier alvéole…
En particulier, les compléments susceptibles de conduire à des modifications de conception, tels que la consolidation des connaissances des propriétés de la roche hôte au droit des structures profondes détectées au nord du quartier HA, l’évolution de dispositions de compartimentage et d’intervention en cas d’incendie, la démonstration de la sûreté de l’exploitation des alvéoles HA et de la fermeture des alvéoles MA-VL, ainsi que les dispositions de surveillance, devront faire l’objet d’une évaluation avant le creusement des ouvrages concernés. S’agissant des ouvrages de fermeture, des éléments complémentaires sont nécessaires en vue de rendez-vous d’évaluation au cours de la phase industrielle pilote. Concernant les déchets bitumés, l’examen de leurs conditions de stockage doit se poursuivre. Ces compléments devront être pris en compte dans l’établissement du programme de la phase industrielle pilote, dont les objectifs et critères de réussite restent préliminaires à ce stade.
Enfin, la flexibilité de l’installation constitue un enjeu fondamental afin de garantir la gestion sûre de l’ensemble des déchets de l’inventaire de référence, y compris en cas d’évolution de l’architecture ou de la conception de l’installation considérées au stade de la DAC. S’agissant de l’adaptabilité de Cigéo à l’inventaire de réserve, il n’a pas été identifié, à ce stade des études, de point rédhibitoire lié à la sûreté du stockage des CU et des déchets FA-VL. Dans le cas où il serait envisagé d’y stocker d’autres déchets que ceux de l’inventaire de référence, une démonstration de sûreté complémentaire devra être apportée.
Ces différents rendez-vous appelés par l’expertise du dossier ont vocation à être encadrés par des prescriptions techniques que l’ASNR pourra prendre en application du décret d’autorisation de création. Ils donneront lieu le cas échéant à des actions de dialogue avec les parties prenantes et le public, afin de conforter la participation des citoyens tout au long de la vie de l’installation, telle qu’elle est appelée par la loi.