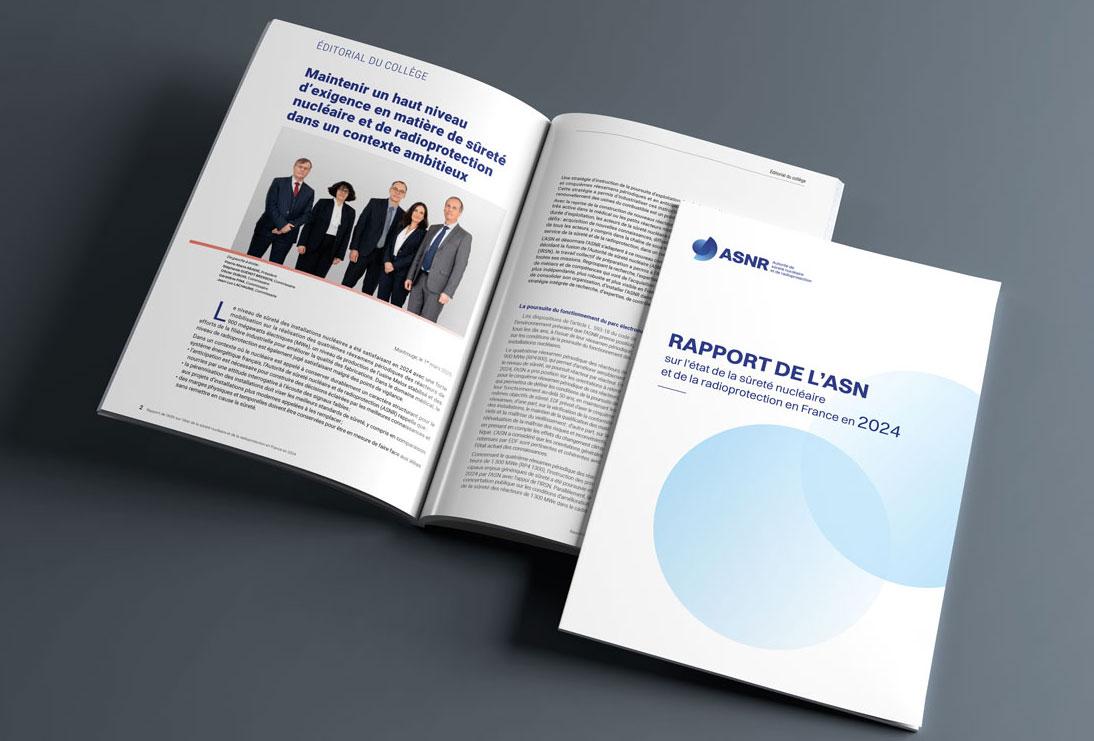Région Auvergne-Rhône-Alpes : sûreté nucléaire et radioprotection en 2024
En 2024, le niveau de la sûreté nucléaire et de la radioprotection reste globalement satisfaisant
À l’occasion de la parution du rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, la division de Lyon de l’ASNR présente les conclusions des actions de contrôle menées en 2024 en région Auvergne-Rhône-Alpes [1].
Ce qu’il faut retenir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes
En 2024, l’ASN a réalisé 339 inspections dans la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, dont 115 dans les centrales nucléaires du Bugey, de Saint‑Alban, de Cruas‑Meysse et du Tricastin, 100 dans les usines, les installations de recherche et les sites en démantèlement, 89 dans le nucléaire de proximité, 15 dans le domaine du transport de substances radioactives (TSR) et 20 concernant les organismes et laboratoires agréés par l’ASN.
L’ASN a par ailleurs réalisé 22 journées d’inspection du travail, dans les quatre centrales nucléaires et sur le site de Creys‑Malville.
En 2024, 21 événements significatifs classés au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (échelle INES) ont été déclarés à l’ASN, dont 19 survenus dans les installations nucléaires de base (INB) et deux dans le nucléaire de proximité. Par ailleurs, un événement significatif pour la radioprotection survenu sur la centrale nucléaire du Tricastin a été classé au niveau 2 de l’échelle INES et un événement, relatif à l’irradiation par erreur d’une zone saine lors du traitement d’un patient par radiothérapie, a été classé au niveau 2 de l’échelle ASN‑SFRO (échelle spécifique pour les événements de radioprotection affectant des patients dans le cadre d’une procédure de radiothérapie).
Enfin, dans le cadre de leurs missions de contrôle, les inspecteurs de l’ASN ont dressé un procès- verbal relatif aux conditions de prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les travailleurs d’une entreprise de radiographie industrielle. Dans le cadre de la même inspection, un signalement, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et relatif à une potentielle tromperie sur une prestation de service, a été adressé au procureur de la République.
Domaine médical
En 2024, la radioprotection dans le domaine médical reste globalement satisfaisante, bien que plusieurs signaux faibles appellent à la vigilance. Des tensions sur les effectifs (manipulateur en électroradiologie médicale, physiciens médicaux, médecins), une externalisation mal encadrée de certaines missions (notamment en imagerie médicale), ainsi qu’une progression rapide de la télé radiologie contribuent à une complexification des organisations de soins et à une dilution des responsabilités.
Fait marquant
L’année 2024 confirme par ailleurs une accélération de l’innovation thérapeutique, avec l’émergence de techniques comme la radiothérapie interne vectorisée (RIV), la radiothérapie flash ou l’installation d’équipements compacts comme le ZAP-X®. Ces évolutions appellent une adaptation rapide du système de soins pour garantir une prise en charge sécurisée.
L’appropriation des enjeux de radioprotection sur l’ensemble de la chaîne depuis la conception jusqu’à la gestion des déchets et effluents est indispensable, tout particulièrement dans l’accompagnement de l’innovation, et constitue un sujet de vigilance pour l’ASN.
Domaine industriel, vétérinaire et en recherche des rayonnements ionisants
Ces secteurs présentent une grande diversité d’activités, d’établissements et d’applications. En matière de radioprotection, l’appréciation de l’ASN reste contrastée, mais dans la continuité des années précédentes. En particulier, l’ASN note un maintien global des efforts mais des écarts persistants selon les secteurs, la maturité des structures et les ressources consacrées.
Focus sur la radiographie industrielle
En raison de leurs enjeux en radioprotection et des risques associés, la radiographie industrielle, en particulier la gammagraphie, reste un secteur prioritaire. En 2024, l’ASN a réalisé 26 inspections chez des opérateurs de ce secteur en Auvergne-Rhône-Alpes. Si les obligations de base sont généralement respectées par les opérateurs, des failles demeurent dans la signalisation des chantiers, la mise en œuvre des vérifications réglementaires et la coordination entre donneurs d’ordre et entreprises.
Le contrôle des centrales nucléaires de production d’électricité exploitées par EDF (Bugey, Saint-Alban, Cruas-Meysse et Tricastin)
Centrale nucléaire du Bugey
L’ASN considère que la centrale nucléaire du Bugey est exploitée et maintenue de façon assez satisfaisante dans le contexte d’un programme industriel chargé. L’ASN relève que le site se distingue sur certaines thématiques comme la gestion du risque incendie. Il est toutefois à noter que la quatrième visite décennale du réacteur 3, la dernière du site, a subi de nombreux aléas.
Les performances de la centrale en matière de radioprotection des travailleurs et de protection de l’environnement se sont améliorées et la sécurité des travailleurs s’est maintenue à un niveau satisfaisant malgré le contexte industriel chargé.
Centrale nucléaire de Saint-Alban
L’ASN considère que la centrale nucléaire de Saint-Alban est exploitée et maintenue de façon satisfaisante dans un contexte d’activité industrielle soutenue. Les arrêts pour rechargement des réacteurs ont été conduits dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
Les performances de la centrale en matière de radioprotection et de sécurité des travailleurs sont satisfaisantes. L’ASN considère que le traitement des aléas techniques impactant les dispositifs de protection de l’environnement est en amélioration
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse
L’ASN considère que le plan d’amélioration de la rigueur d’exploitation, mis en place en 2023 par la centrale de Cruas-Meysse et prolongé en 2024, doit être poursuivi, dans le contexte d’un programme industriel chargé. La quatrième visite décennale du réacteur 3, la première du site, a été réalisée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
En matière de radioprotection, des améliorations des pratiques ont été observées en 2024 mais les premiers résultats de l’année 2025 ne sont pas à l’attendu. En matière de protection de l’environnement, les performances de la centrale sont stables, toutefois l’ASN attend des améliorations. En matière de sécurité des travailleurs, les résultats du site en 2024 sont satisfaisants mais ceux du début 2025 appellent à la vigilance.
Centrale nucléaire du Tricastin
L’ASN considère que les performances de la centrale du Tricastin en matière de sûreté nucléaire sont satisfaisantes. La quatrième visite décennale du réacteur 4, la dernière du site, s’est déroulée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
En matière de radioprotection, les contrôles de l’ASN ont montré des points de fragilité, particulièrement concernant la propreté radiologique pendant les arrêts de réacteur. En matière de protection de l’environnement, l’organisation du site pour répondre aux exigences réglementaires a progressé. En matière de sécurité des travailleurs, les résultats du site sont satisfaisants, mais en retrait par rapport à l’année 2023.
Autres installations nucléaires
Site Orano du Tricastin
Les installations du « cycle » du Tricastin couvrent principalement les activités de l’amont du « cycle du combustible » et sont exploitées par Orano Chimie‑Enrichissement dénommé « Orano » ci‑après : L’installation TU5 ; l’usine W ; les anciennes installations ex‑Comurhex et l’usine de conversion Philippe Coste ; l’ancienne usine d’enrichissement Georges Besse I ; l’usine d’enrichissement Georges Besse II ; les parcs uranifères ; les ateliers de maintenance, de traitement des effluents liquides et de conditionnement de déchets ; le laboratoire Atlas ; une installation nucléaire de base secrète.
À l’issue des inspections qu’elle a conduites en 2024, l’ASN considère que le niveau de sûreté des installations du site Orano du Tricastin est satisfaisant et que l’exploitant s’est amélioré en matière de radioprotection des travailleurs. Le retard dans le projet d’extension de l’usine W qui traite l’uranium appauvri et dans le traitement du passif historique fait l’objet d’une attention soutenue de l’ASN.
Usines Framatome de fabrication de combustibles nucléaires de Romans-sur- Isère
L’ASN considère que le niveau de sûreté des installations de Framatome est satisfaisant. L’exploitant a entrepris depuis 2017 la création d’une nouvelle zone uranium aux standards de sûreté améliorés. Après des retards, Framatome s’est mobilisé pour terminer ce chantier et l’Autorité a autorisé en novembre 2024 sa mise en service.
Réacteur à haut flux (RHF) de l’Institut Laue-Langevin
Au regard des actions de contrôle conduites en 2024, l’ASN considère que le RHF est exploité dans des conditions de sûreté satisfaisantes. L’année 2024 a été marquée par la mise en œuvre de modifications visant à améliorer la sûreté de l’installation, avec des travaux d’ampleur sur le système de lutte contre l’incendie et le renforcement sismique du pont polaire de manutention.
Réacteur Superphénix et atelier pour l'entreposage du combustible (APEC) de Creys-Malville
L’ASN considère que la sûreté des opérations de démantèlement du réacteur et d’exploitation de l’APEC est satisfaisant. L’année 2024 a été marquée par la fin du démantèlement du bouchon couvercle du cœur et le transfert du faux sommier de la cuve du réacteur, pièce massive activée et particulièrement irradiante, vers un atelier de découpe téléopéré réalisé dans le bâtiment réacteur.
Pour en savoir plus :
- Présentation de la conférence de presse, bilan 2024 - ASNR Lyon
(PDF - 2.16 Mo) - Communiqué de presse du 10 juin 2025 - ASNR Lyon
(PDF - 591.77 Ko)
La division de Lyon de l’ASNR assure la mise en œuvre des missions de contrôle sur le terrain pour toutes les installations et activités nucléaires civiles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle instruit les demandes d’autorisation, vérifie la conformité à la réglementation relative à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la gestion des équipements sous pression ainsi qu’à la protection de l’environnement. Elle assure également l’inspection du travail dans les centrales nucléaires.
En cas de situation d’urgence radiologique, elle assiste les préfets dans la protection des populations et participent à la préparation des plans d'urgence. La division de Lyon est aussi active dans l’information du public, notamment via les Commissions locales d’information (CLI), et entretient des liens avec les médias, élus, associations, exploitants et autorités locales.
[1] L’ASNR, née de la réunion au 1er janvier 2025 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), a élaboré ce rapport. Les activités 2024 sont exprimées au nom de l’ASN et les considérations plus générales ou de projections sont exprimées au nom de l’ASNR.