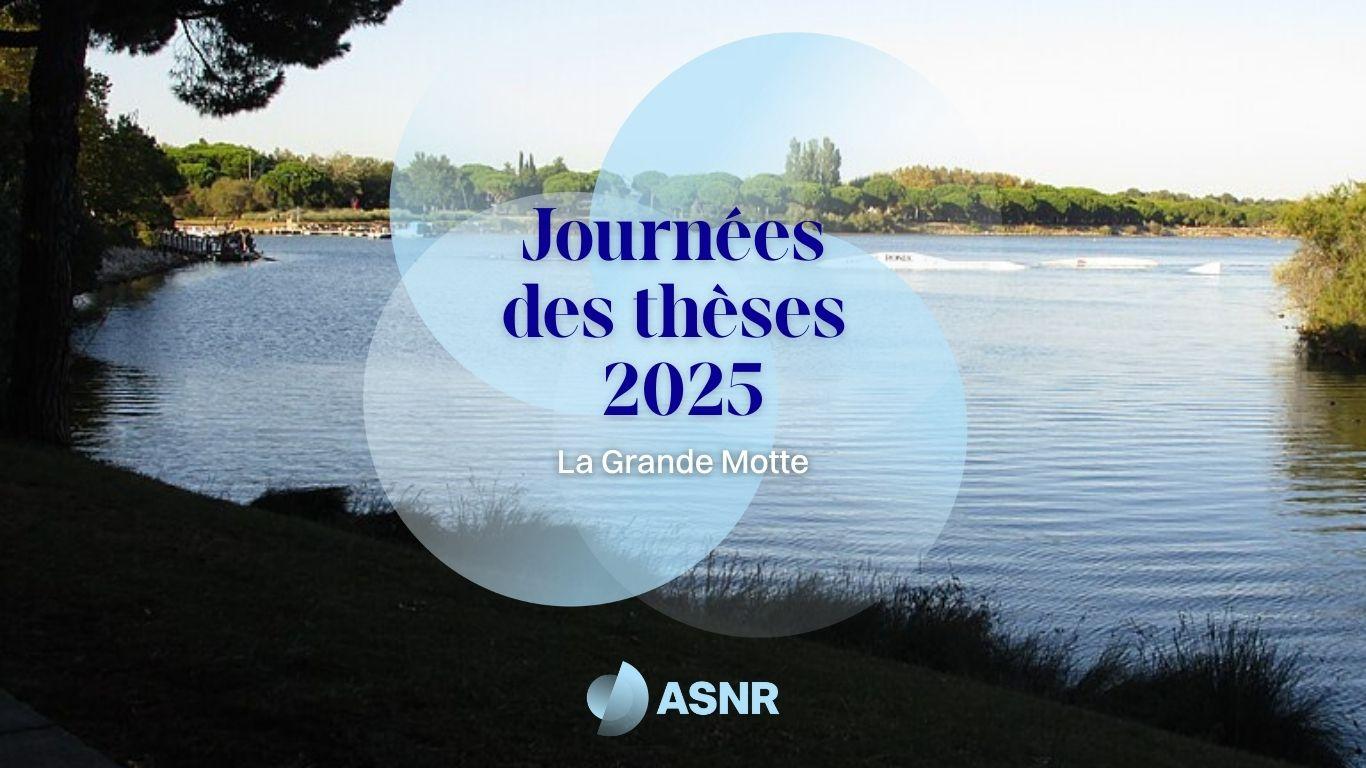Projet AMHYCO : mieux comprendre l’accident nucléaire grave
Projet AMHYCO : un projet européen pour mieux comprendre les risques d’accident grave en centrale nucléaire
Le projet AMHYCO (Towards an Enhanced Accident Management of the Hydrogen/CO Combustion Risk), financé par le programme de recherche Euratom H2020 et labellisé par la SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform), a réuni 13 partenaires de 7 pays européens et du Canada, dont, pour la France, l’ASNR, présente aux côtés de Framatome et du CNRS Coordonné par l’Université Polytechnique de Madrid, le projet AMHYCO avait pour objectif d’améliorer la compréhension des phénomènes liés aux gaz combustibles (hydrogène et monoxyde de carbone) en cas d’accident grave dans une centrale nucléaire. Il s’inscrit dans la continuité du projet SAMHYCO NET.
Un enjeu de sûreté : maîtriser les gaz combustibles
Lors d’un accident grave dans une centrale nucléaire, l’hydrogène (H₂) et le monoxyde de carbone (CO) peuvent être produits et relâchés dans l’enceinte de confinement des réacteurs. Ces gaz inflammables peuvent conduire, en cas de combustion, à des charges en pression et en température capables de compromettre le fonctionnement des équipements nécessaires à la gestion des accidents graves ; ils peuvent aussi affecter l’intégrité de l’enceinte de confinement et entraîner, par conséquent, le rejet de matières radioactives dans l’environnement.
L’objectif du projet AMHYCO était de mieux comprendre ces phénomènes, et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la gestion de ces risques.
Une approche expérimentale et collaborative
Le projet s’est appuyé sur des expériences en laboratoire pour affiner les modèles de la recombinaison1 catalytique de l’hydrogène et du monoxyde de carbone et de la combustion des mélanges représentatifs de l’atmosphère des enceintes de confinement en situation d’accident grave. Cela a permis aussi de définir des critères pour évaluer a priori le risque d’explosion en phase tardive d’un accident.
En outre, des simulations numériques de scénarios accidentels ont été menées pour mesurer le bénéfice des connaissances acquises.
Le séminaire de clôture s’est tenu à Madrid fin février 2025, rassemblant une soixantaine de participants. Il a marqué la conclusion de quatre ans et demi de recherche collaborative visant à améliorer la gestion des risques liés à la combustion de l'hydrogène et du monoxyde de carbone dans les centrales nucléaires européennes de génération II et III2.
Bilan technique et valorisation des résultats du projet
Le projet AMHYCO a atteint les objectifs scientifiques et techniques qui lui étaient assignés. Il a permis de produire une base de données expérimentales ainsi que des résultats de simulation de scénarios accidentels à l’aide d’outils de type LP (lumped parameter), 3D et CFD (computational fluid dynamics). Ces données ont été utilisées pour réviser les corrélations de recombinaison de référence, définir les domaines d’inflammation, et établir des critères d’accélération de flamme dans des conditions représentatives de la phase tardive d’un accident grave. Par ailleurs, certaines données expérimentales générées ont servi à l’organisation du benchmark ETSON-AMHYCO en lien avec le réseau ETSON (European Technical Safety Organisations Network). La réunion de clôture de celui-ci est prévue les 26 et 27 juin 2025 à Fontenay-aux-Roses.
1. Réaction permettant de consommer l’hydrogène ou le monoxyde de carbone de manière contrôlée
2. Le parc des réacteurs de production d’électricité actuellement en exploitation en France comprend un total de 56 réacteurs à eau sous pression (REP), dits « de génération II », et un réacteur EPR (European Pressurized water Reactor) est dit « de génération III ». (source site irsn.fr)
Pour en savoir plus