Conférence ICRER 2024 : demandez le programme !
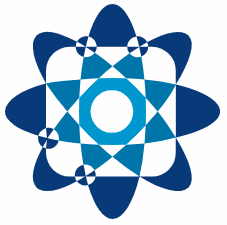
La 6ème édition de la conférence ICRER (International Conference on Radioecology & Environmental Radioactivity), organisée conjointement par l’IRSN et l'Autorité norvégienne de radioprotection et de sûreté nucléaire (DSA) en collaboration avec l'IUR, l'AIEA, l'UNSCEAR, EURADOS, la CIPR, l’AER, le JER et la SFRP se déroule du 24 au 29 novembre 2024 au palais du Pharo à Marseille.
Au-delà des thèmes traditionnels de la radioécologie et de la radioactivité environnementale (évaluation de l’impact des radionucléides sur l’environnement, compréhension et modélisation des processus de transfert, développement en métrologie, surveillance environnementale, gestion des matériaux contenant des radionucléides d’origine naturelle, déchets, etc.), ICRER 2024 sera l’occasion d’aborder des sujets émergents tels que l’utilisation des data sciences ou encore l’impact du changement climatique sur le transfert des radionucléides.
Cette conférence, qui rassemble des scientifiques, des acteurs industriels, des régulateurs et des experts, contribuera notamment à l'amélioration des connaissances, des méthodes et des outils nécessaires pour renforcer la protection des personnes et de l'environnement contre les effets des radiations.
Cette année, 5 orateurs, invités par le comité d’organisation, donneront des conférences plénières :
- Gonéri Le Cozannet (BRGM), présentera les principales conclusions du 6ème rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
- Hildegarde Vandenhove (AIEA), Deborah Oughton (NMBU), Georg Steinhauser (TU Wien) et Mike Wood (University of Salford) viendront enrichir le programme en partageant leurs perspectives sur des enjeux liés à la radioécologie .
D'autres événements se dérouleront en marge de la conférence. Ainsi, des formations seront proposées, dont deux animées par l’IRSN :
- «Ecosystem approaches in radioecology» par Rodolphe Gilbin
- «Radiation-induced transgenerational and multigenerational effects in human and non-human biota» par Olivier Armant.
Des réunions spécifiques seront également organisées, parmi lesquels le «Ring of Five», animé par Olivier Masson (IRSN), ainsi qu’une réunion en partenariat avec l'AIEA, portant sur les radionucléides dans les organismes marins, à laquelle participera Sabine Charmasson (IRSN).
Pour la première fois, des entreprises ont parrainé l’événement. Parmi celles-ci, Algade, Agilent, Bertin Technologies, ESI, HTDS et Triskem bénéficieront d’un stand dédié pour présenter leurs activités et échanger avec les participants. La fédération de recherche ECCOREV et la région SUD PACA apportent également leur soutien en tant que parrains.





