L’ASNR participe la réunion plénière de WENRA organisée les 8 et 9 avril à Bled (Slovénie)
Les 8 et 9 avril 2025, l’ASNR, représentée par Olivier Gupta, son directeur général et vice-président de l’association, et Luc Chanial, conseiller international auprès du comité exécutif, ont participé à la réunion plénière de WENRA, l’association des responsables d’Autorités de sûreté nucléaire d’Europe.
Réunis à Bled (Slovénie) par SNSA, l’autorité de sûreté nucléaire slovène, les membres de WENRA ont abordé plusieurs sujets d’importance.
Plusieurs discussions thématiques ont été conduites lors de cette réunion, notamment sur :
- les conditions d’application des critères d’adhésion à l’association actuellement en vigueur au vu de récentes expressions d’intérêt de certaines autorités de sûreté nucléaire non-européennes à rejoindre WENRA en tant qu’observatrices ;
- l’état des lieux de la sûreté des installations nucléaires en Ukraine, notamment celle du réacteur n° 4 de Tchernobyl à la suite du bombardement de l’arche assurant son confinement par l’armée russe le 14 février dernier, et celle de la centrale de Zaporijjia ;
- le niveau de sûreté requis par les autorités pour assurer une protection suffisante des populations vivant autour des installations nucléaires, tout en prenant en compte le développement de nouveaux types de réacteurs, comme les petits réacteurs modulaires ;
- les modalités de participation du public dans le cadre des évaluations périodiques de sûreté des installations nucléaires et la responsabilité respective des exploitants et autorités de sûreté nucléaire dans ces exercices périodiques ;
- les principes directeurs à considérer dans le cadre de la mise en place d’une démarche de cybersécurité applicable aux installations nucléaires ;
- la poursuite d’exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans ; le processus mis en place par la NRC, l’autorité de sûreté nucléaire américaine, pour autoriser l’exploitation de certains réacteurs jusqu’à 80 ans a en particulier été présenté ;
- la possibilité de conduire des travaux d’évaluation conjoints de la sûreté des nouveaux réacteurs ; PAA, l’autorité de sûreté nucléaire polonaise, a présenté son approche pour prendre en compte les travaux réalisés par son homologue américaine, la NRC, dans le cadre de son évaluation du modèle de réacteur AP1000 ;
- les attentes, en termes d’efficacité, vis-à-vis des autorités de sûreté nucléaire pour répondre aux enjeux portés par le nouveau contexte international, et les initiatives conduites par certains membres de WENRA dans ce domaine.
Les groupes de travail ont rapporté sur leurs activités respectives. WENRA a dans ce cadre confirmé le programme de travail du ad hoc groupe sur les enjeux en matière de compétences et du recrutement mis en place au printemps 2023.
Assurer la sûreté nucléaire en contexte de perturbation prolongée
La Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie à Bruxelles a accueilli le 7 et 8 avril 2025 l’atelier « Ensuring safety in a context of prolonged disruption » (assurer la sûreté dans un contexte de perturbation prolongée), coorganisé par l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) et le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne.
Un événement multidisciplinaire pour une problématique globale
Cet événement a réuni des experts, des chercheurs, des représentants d’organisations gouvernementales et d’autres parties prenantes pour réfléchir collectivement aux défis posés par les perturbations prolongées dans le secteur nucléaire.
Un enjeu stratégique : garantir la sûreté dans un monde incertain
L’atelier s’est inscrit dans une dynamique de valorisation du retour d’expérience des situations récentes de perturbation prolongée telles que la pandémie de COVID-19, les conflits armés, le changement climatique ou encore les catastrophes naturelles ou technologiques pour mieux se préparer à la gestion de situations équivalentes dans le futur. Ces événements ont mis en lumière la nécessité d’adapter les pratiques de gestion de crise dans le secteur nucléaire.
Les discussions ont porté sur plusieurs axes clés :
- L’impact du travail à distance sur les organisations et la continuité des opérations critiques ;
- Le renforcement de l’autonomie des équipes sur le terrain, indispensable en situation de crise prolongée ;
- Les défis de l’apprentissage organisationnel dans des contextes évolutifs et incertains ;
- La poursuite de la recherche et développement pour anticiper et gérer l’imbrication de crises multiples.

Une approche systémique et collaborative
Les intervenants ont souligné l’importance d’une coordination renforcée entre les parties prenantes – autorités de sûreté, exploitants, fournisseurs, institutions internationales – pour garantir une réponse efficace et cohérente. L’atelier a également mis en avant la nécessité d’une approche systémique et globale, intégrant les dimensions humaines, techniques et organisationnelles.
Des thématiques transversales telles que la formation, la santé mentale et le bien-être des travailleurs, ou encore la continuité d’activité et les opportunités offertes par la numérisation ont été abordées, dans une perspective d’adaptation durable à une situation dégradée.
Vers une culture de résilience
Cet atelier a permis de poser les bases d’une culture de résilience partagée, essentielle pour faire face aux crises futures, qu’elles soient d’origine technologique, environnementale, sanitaire ou géopolitique. Il a également renforcé les liens entre les acteurs européens et internationaux du secteur nucléaire, dans une logique de coopération et d’innovation.


Journées des thèses 2025 : le premier temps fort de la recherche estampillé ASNR
Du 1er au 4 avril 2025, l’ASNR a organisé ses premières Journées des thèses à La Grande-Motte.
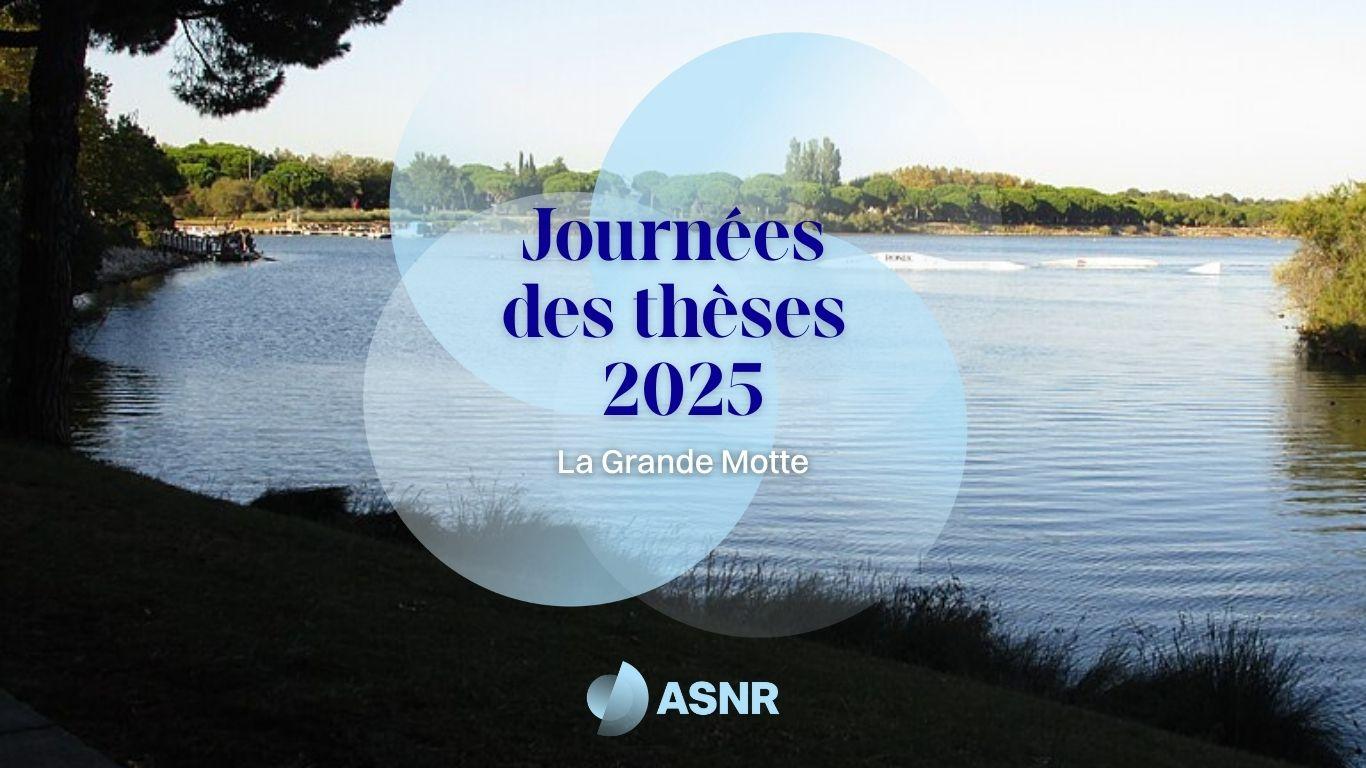
Étang du Ponant
- © Anthony Levrot, Wikimedia Commons, License CC BY-SA 4.0Un événement majeur qui a réuni près de 90 doctorants travaillant sur des sujets en lien avec la sûreté nucléaire, la radioprotection, la santé et l’environnement, ainsi que leurs encadrants -tuteurs à l’ASNR et directeurs de thèse ASNR ou académiques, experts et partenaires industriels, soit plus de 200 scientifiques.
Ces journées, issues d’une longue tradition de l’ex-IRSN et désormais inscrites dans l’agenda de l’ASNR, sont l’occasion de valoriser la diversité et la qualité des travaux de recherche menés dans ou pour l’établissement. Elles permettent aux doctorants de présenter leurs travaux et favorisent les échanges entre doctorants, encadrants, chercheurs, experts et partenaires de l’ASNR, tout en montrant les apports de ces travaux aux enjeux sur lesquels l’ASNR aura à prendre position. Durant ces trois journées, présentations orales, expositions de posters, moments d’échanges, conférences et tables rondes étaient donc au programme.
Cette première édition sous bannière ASNR a permis de mettre en lumière l’excellence scientifique des thèses en cours, leur pertinence au regard des enjeux techniques et sociétaux. Dans son discours d’ouverture, Olivier Dubois, commissaire de l’ASNR, a souligné « la richesse et l’importance des recherches menées par les doctorants qui alimenteront les décisions du collège de l’ASNR dans les années à venir. »
Olivier Gupta, directeur général de l’ASNR, a conclu ces journées en soulignant que « la formation par la recherche est une excellente formation, quels que soient les métiers auxquels on se destine » et que « la place de la recherche au sein de l’ASNR est essentielle et contribue au rayonnement français et international de la nouvelle Autorité ».
Cinq doctorants ont été récompensés pour la qualité de leurs posters :
- Le 1er prix a été attribué à Mme Léa Duffaut du Laboratoire d'expérimentation en mécanique et matériaux (LE2M) pour son poster sur l’étude du fluage en rampe de température des gaines de crayons combustibles en alliage de zirconium revêtues de chrome.
- Les 2e prix ex-aequo ont été décernés à M. Nicolas Cailler-Gruet du Laboratoire de radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale (LRTOX) et Mme Myriam Sebaa du Laboratoire d'expérimentation environnement et chimie (L2EC)
- Les 3e prix ex-aequo sont revenus à Mme Louise de Roffignac du Laboratoire de radiobiologie des expositions médicales (LRMed) et M. Taha Hamadene du Laboratoire de recherche sur les transferts des radionucléides dans les écosystèmes aquatiques (LRTA).
La lauréate du 1er prix bénéficie d’un soutien de 500 € pour organiser un événement festif avec son laboratoire. Les cinq posters primés seront également affichés sur les principaux sites de l’ASNR.

Rejoignez les doctorants de l'ASNR
Chaque année, l’ASNR propose une trentaine de nouveaux sujets de thèses de doctorat, associées à de nombreuses écoles doctorales. La campagne de recrutement des thèses 2025 est toujours en cours !
Vous pouvez consulter les 31 sujets actuellement disponibles pour des contrats doctoraux proposés par l’ASNR (doctorants salariés par l’ASNR) dans la rubrique des offres d’emploi de l’Autorité : https://irsn-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx, type de contrat « doctorat ». Il ne reste plus que quelques jours pour candidater !
De plus certains sujets sont proposés en partenariats avec des institutions académiques qui recruteront le doctorant. Il s’agit notamment des offres ci-dessous :
- Etude expérimentale d’explosions de fumées issues de la ré-inflammation des produits de combustion imbrûlés lors d'un incendie dans une enceinte ventilée mécaniquement (ref Th RES 25-4) : https://www.imt-mines-ales.fr/sites/default/files/media/2025-02/Sujet%20th%C3%A8se%20IMT.pdf
- Etude expérimentale de la pyrolyse et de la propagation du feu sur des plaques de matériaux modèles de gaines de câbles électriques (ref Th RES 25-5) https://www.imt-mines-ales.fr/sites/default/files/media/2025-02/PhD_ENG-EXPYRATION.pdf
- ARISE² : Analyse de la nucléation de bulles de Radiolyse sous flux gamma et de leur relâchement dans des bItumeS et des Enrobés par méthode ultrasonorE. // ARISE²: Analysis of the nucleation of radiolysis bubbles under gamma flux and their release in bIt (ref Th RES 25-16)
- Etude des doses reçues par le personnel navigant de l’aviation civile liées aux Flashs Gamma Terrestres et autres phénomènes électriques atmosphériques (Ref Th SAN 25-11) : https://adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?site=adumR&matricule_prop=62827
- Propagation multi-incertitudes dans la chaine de modélisation du transport atmosphérique des polluants issus d’accidents industriels ou nucléaires : https://www.umr-cnrm.fr/IMG/pdf/sujet-these-natech.pdf
Comurhex : l’ASNR met en demeure Orano Chimie-Enrichissement
L’ASNR met en demeure Orano Chimie-Enrichissement de respecter une prescription de la décision CODEP-CLG-2020-038011 du président de l’ASN du 23 juillet 2020 relative au démantèlement de l’INB 105, dénommée Comurhex.
L’ancienne usine de conversion de l’uranium Comurhex 1, située dans le périmètre de l’installation nucléaire de base (INB) 105, sur le site nucléaire du Tricastin et exploitée par Orano, a été arrêtée définitivement en 2017. Suite à la publication du décret de démantèlement de l’installation en 2019, l’ASN a imposé à Orano plusieurs prescriptions techniques visant à encadrer la sûreté des opérations de démantèlement dans la décision CODEP-CLG-2020-038011.
Parmi celles-ci, la prescription [INB 105 - DEM 5] prévoit qu’Orano assure le reconditionnement et l’évacuation des matières et déchets des aires d’entreposage 61 et 79 avant le 31 décembre 2024. En effet, leurs conditions d’entreposage ne répondent pas aux standards de sûreté les plus récents, pris en compte dans le cadre du dernier réexamen de l’installation, et il a été jugé préférable de prioriser leur évacuation plutôt que leur renforcement, ces aires étant en tout état de cause destinées à être démantelées1.
Par la suite, Orano Chimie-Enrichissement a affiné la caractérisation des matières et déchets et les modalités de traitement des imbrûlés de fluoration (IUF)2 en vue de leur entreposage définitif. Ces opérations induisent un décalage notable des échéances d’évacuation de l’aire d’entreposage 61. L’ASN a demandé en 2023 à Orano Chimie-Enrichissement de préciser le nouveau calendrier d’évacuation de ces matières et déchets. Suite à différents aléas d’exploitation, l’exploitant a finalement repris le traitement et le désentreposage des fûts d’IUF à la cadence prévue au cours de l’année 2024, ce qui est satisfaisant.
Néanmoins, l’aire 61 contient aujourd’hui encore environ deux tiers des fûts d’IUF initialement présents au commencement des opérations de démantèlement de l’installation. Ces substances présentent un risque radioactif et chimique toxique ; la vétusté de certains emballages ne permet pas de garantir la robustesse de leur confinement. L’aire 79 ne contient plus, quant à elle, de matière uranifère, mais uniquement des déchets sous forme de boues et résines, qui présentent un enjeu de sûreté plus limité.
Une inspection conduite le 17 janvier 2025 par la division de Lyon de l’ASNR a confirmé le dépassement de l’échéance imposée par la prescription [INB 105 - DEM 5], des fûts de matière étant encore stationnés sur l’aire 61.
Un rapport contradictoire relatif à ce constat a alors été établi par l’ASNR en application de l’article L. 171 6 du code de l’environnement. En réponse à ce rapport, Orano a présenté un calendrier conduisant à l’évacuation des matières et déchets présents sur l’aire 61 avant la fin du mois de septembre 2026. Ce calendrier est cohérent avec les éléments techniques présentés par l’exploitant fin 2024 et, sous réserve du maintien de la bonne cadence de traitement actuelle, paraît justifié et étayé.
Considérant que le désentreposage de ces fûts représente un enjeu de sûreté prioritaire et qu’il ne doit pas subir de nouveaux retards, l’ASNR met en demeure Orano de respecter la prescription [INB 105 – DEM 5] de la décision CODEP-CLG-2020-038011 du 23 juillet 2020 au plus tard le 30 septembre 2026 en assurant le désentreposage des matières et déchets présents sur l’aire 61.
1. De manière générale, l’ASNR considère que l’évacuation du « terme source », c’est-à-dire des substances radioactives présentes dans une installation, est l’action qu’il convient de prioriser, dès lors que c’est possible, dans tous les projets de démantèlement. Cette évacuation permet en effet de réduire substantiellement et définitivement le potentiel de risque que présente l’installation.
2. Les imbrûlés de fluoration (IUF) sont des matières résiduelles issues de la conversion de l’uranium naturel ou de retraitement lors de l’exploitation de l’usine Comhurex.
Lancement d’une étude radiologique autour de l’ancien site minier de l’Ecarpière
Le 19 mars dernier, à l’invitation du Maire de Gétigné, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) a présenté l’étude radiologique de l’ancien site minier de l’Ecarpière (Gétigné – Saint-Crespin-sur-Moine).
En concertation avec l’exploitant (Orano) et la Commission de suivi du site (qui réunit préfecture, élus, associations et services de l’État), l’étude radiologique déployée par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est un dispositif innovant d’études scientifiques participatives autour de l’ancien site minier de l’Écarpière.
Indépendante de la surveillance réglementaire menée par l’exploitant, l’étude radiologique du site de l’Ecarpière poursuit 3 objectifs principaux :
- Améliorer les connaissances scientifiques qui permettront de mieux caractériser l’influence du site sur son environnement proche ;
- Estimer de manière réaliste l’exposition radiologique et chimique des populations avoisinantes notamment via une enquête « mode de vie » sur les denrées locales consommées et les usages du site et de son environnement* ;
- Impliquer concrètement la population à chaque étape du programme depuis sa mise en place jusqu’à la restitution finale en les invitant à rejoindre le groupe de suivi.
* Pour participer à l’enquête mode de vie, cliquez sur ce lien
Pour en savoir plus
8e réunion d’examen de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Du 17 au 28 mars 2025, l’ASNR a participé à la réunion d’examen de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs qu’elle a par ailleurs présidée par l’intermédiaire de son commissaire Jean-Luc Lachaume. Cette réunion à laquelle soixante-sept pays étaient représentés s’inscrit dans un processus triennal d’examen par les pairs au cours duquel chaque partie contractante doit rendre compte de son programme national. Il s’agit du seul instrument légal, à l’échelle mondiale, dans ce domaine.
Pour l’ASNR, cette réunion d’examen constitue l’aboutissement d’un important travail en lien avec le ministère chargé de l’environnement, l’Andra et les exploitants d’installations nucléaire qui a consisté en la production d’un rapport national et en la participation à un exercice de questions-commentaires et réponses écrites avec les autres parties contractantes à la convention.
Cette réunion était, en outre, particulière pour la France et l’ASNR. En effet, son président canadien étant dans l’impossibilité d’y participer, il a demandé, quelques jours avant la session d’ouverture, au commissaire Jean-Luc Lachaume d’en assurer la présidence en sa qualité de vice-président élu.
Durant la première semaine, la réunion d’examen a été essentiellement consacrée aux présentations des rapports nationaux, par groupes de pays, lors de huit sessions parallèles. Une équipe de référents mise en place par l’ASNR a suivi les débats et est intervenue dans chacun de ces groupes auxquels, par ailleurs, participaient deux collaborateurs de l’ASNR en tant que rapporteur et coordonnateur officiels d’un groupe de pays.
Le rapport de la France a été présenté le mercredi 19 mars par le directeur général de l’ASNR, Olivier Gupta, avec la participation de représentants de l’Andra.
Cette présentation a mis en avant les progrès accomplis en France dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs ces trois dernières années ainsi que les enjeux à venir.
Une bonne pratique et six domaines de bonne performance
Les pays du groupe ont identifié pour la France les « domaines de bonne performance » suivants :
- la nouvelle méthode de suivi des projets de reprise et de conditionnement des déchets mise en place par l’ASNR,
- le dépôt par l’Andra, en 2023, de la demande d’autorisation de création de l’installation Cigéo,
- la poursuite du développement par EDF du projet d’installation visant à recycler les déchets métalliques de très faible activité (le Technocentre),
- la mise en place d’un dispositif d’évaluation et de prospective concernant le cycle du combustible nucléaire,
- la mise en place, dans le cadre du Comité directeur pour la gestion post-accidentelle (Codirpa) d’un groupe de travail sur la gestion des déchets radioactifs engendrés par un accident nucléaire,
- la participation proactive de l’Andra à l’initiative MEREIA de l’AIEA sur les sites de stockage de surface avec un partage de l’expérience française.
La poursuite des actions de gestion des déchets de faible activité et vie longue et la gestion de certaines sources scellées usagées sans filière de gestion ont par ailleurs été identifiées comme des enjeux pour la France.
Enfin, les nouvelles initiatives de participation du public dans le cadre du projet Cigéo ont été notées comme une « bonne pratique » exemplaire au niveau international. Ces initiatives correspondent à la mise en place d’une consultation des parties prenantes sur le cadrage de l’instruction technique ainsi que la mise en place par le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) d’un comité indépendant de suivi de l’ensemble des démarches de consultation du public sur le projet Cigéo.
En complément de ces sessions, un groupe de travail ouvert présidé par Jean-Luc Lachaume s’est réuni dans le but de faire progresser le processus d’examen par les pairs de la Convention. Les recommandations émises par le groupe, dont plusieurs sont à l’initiative de l’ASNR, ont été validées en séance plénière lors de la deuxième semaine.
En conclusion de la réunion d'examen qui s’est tenue dans une ambiance cordiale et constructive, Jean-Luc Lachaume a fait approuver le rapport de synthèse des deux semaines de travaux, en obtenant le consensus de tous les pays représentés.
L’implication de l’ASNR lors de ce grand rendez-vous international, saluée par les pairs, a permis de promouvoir les actions et les positions françaises dans le domaine et a conforté le statut de l’ASNR en tant qu’acteur de premier plan, au niveau mondial, dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection.





